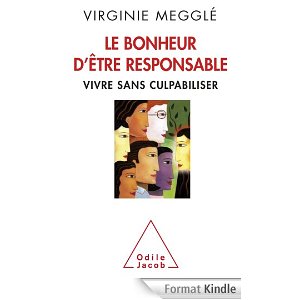Sous la peau – un film de Nadia Jandeau et Katia Scarton-Kim
Sous la peau – un film de Nadia Jandeau et Katia Scarton-Kim
La sidération est causée par un choc. D’une violence inouïe.
« Un coup de poing en pleine gueule, voilà ce que j’ai pris, quand j’ai compris. Ca m’a assumée. J’étais sonnée. Je ne savais plus qui j’étais. Je ne savais plus où j’étais. Plus rien. Je n’entendais plus rien. Je restais bloquée là comme un poteau, sans pouvoir bouger ni parler. Je ne sentais plus rien. Sauf la peur… qu’est-ce que j’ai eu peur ! »
La sidération est un phénomène psychologique créant chez la victime un arrêt du temps. Elle se retrouve figée dans une blessure psychologique traumatique, et les émotions semblent pratiquement absentes. Une culpabilité irrationnelle se développe. La sidération enferme dans le silence et l’incapacité de dire l’épouvante. C’est un blocage total qui protège de la souffrance en s’en distanciant et en l’interdisant, pour ne pas être submergé.
Le traumatisme a des effets à court, moyen et long terme, différents selon le fonctionnement de chacun.
– état de stress intense pouvant durer plusieurs heures, se manifestant par cet état de sidération anxieuse, qui n’est autre que le mécanisme de défense archaïque de camouflage dans un milieu naturel, ou d’un état d’agitation inadaptée
– verbalisation souvent difficile, voire impossible.
– comportement de repli sur soi avec des pleurs et de l’angoisse, avec parfois des expressions physiques (pleurs intenses, tremblements, vomissements…)
– culpabilité omniprésente et honte « je ne sais pas quoi faire ; je n’ai pas su réagir à temps ; c’est ma faute »
– impression de souillure « je suis sale, je me sens sale », développant parfois une compulsion d’hygiène
Un état de stress va apparaître. Le stress est la réaction d’adaptation physiologique aux agressions, retenant étroitement trois composantes : neuro-hormonale, psycho-émotionnelle et comportementale. Cette activation physiologique détermine l’intensité émotionnelle réactionnelle. Un sujet fatigué a des émotions très émoussées par rapport à un état éveillé ; elles n’ont rien de commun avec la résilience qui consiste à dépasser les événements graves et les situations tragiques en gardant sa stabilité personnelle. Au moment du traumatisme, du choc, le système neuro-endocrinien décharge brutalement de l’adrénaline dont témoigne l’état d’agitation, ou au contraire de la sidération avec tétanisation de l’ensemble du corps. L’élévation du cortisol commence par augmenter les capacités adaptatives des neurones (alerte) mais au bout de quelques heures à ce haut niveau il les paralyse et empêche leur « cicatrisation » rapide.
Le cerveau est débordé émotionnellement par cet événement traumatisant auquel il ne peut donner sens, entraînant souvent des modifications de l’état de conscience et des comportements irrationnels qui normalement s’atténuent dans les heures qui suivent.
Des comportements d’évitement vont souvent se développer, comme des mécanismes de défense, afin de permettre à la victime de continuer à « vivre ». Durant cette phase, où il y a déni, le sujet évite toute situation pouvant lui rappeler l’évènement traumatisant (contournement des lieux, changement d’horaires, rejet du téléphone, des mails, rupture des liens familiaux, sociaux…). Puis apparaît une phase de troubles nerveux avec un état d’alerte permanent, des sueurs, troubles du sommeil, angoisses nocturnes, cauchemars… qui peut évoluer en ruminations, anxiété chronique… Si ces troubles durent plus de trois mois, l’état de stress post-traumatique est qualifié de chronique.
Les victimes de violences psychologiques, d’agressions sexuelles, d’attentats, connaissent cet état. Il leur interdit tout mouvement, toute réaction. Elles voudraient courir mais leurs pieds semblent pris dans le sol. Elles voudraient frapper mais elles sont incapables de bouger ne serait-ce qu’un doigt. Elles voudraient hurler mais aucun son ne vient. Elles voudraient pleurer mais sentir une larme couler les terrorisent encore plus. Elles sont sous emprise, celle de la terreur, de l’incompréhension, du refus d’une situation ou d’un comportement inadmissible et inhumain, qui les attaque dans leur individualité, leur personnalité, leur rationalité, et leur émotivité.
Autour d’elles, tout semble se dérouler comme dans un film, lorsque l’action est auraient, que les voix sont déformées, que les images se découpent, seconde après seconde, permettant au cerveau de les enregistrer. Si elles disent ne plus se souvenir, c’est que la mémoire traumatique – ce sentiment d’amnésie – les protège de l’horreur de ce qu’elles ont vécu. Mais le souvenir est bien là, reposant sans être effacé, pouvant se réveiller, remonter à la surface. La mémoire traumatique, comme le déni, offre une protection : celle d’éviter au cerveau de « disjoncter ».
Les évènements récents, actes terroristes, qui se multiplient et prennent diverses formes toutes aussi criminelles et meurtrières, amènent à cet état de sidération, que l’on soit victime, ou témoin, présent, ou téléspectateur, auditeur de ces barbaries. Qui n’est pas resté figé devant sa télé, le soir du 14 juillet 2016, du 13 novembre 2015, ou encore, après l’attaque de Charlie Hebdo, ou l’assassinat du père Hamel à St Etienne du Rouvray ? Comment comprendre les personnes présentes, sur les lieux, incapables soudain de bouger, de courir, de fuir ? Nous sommes tous susceptibles de nous retrouver dans cet état de sidération, de stupeur paralysante, incontrôlable, qui se met à nous gouverner.
Dans le huis-clos des violences intrafamiliales, la sidération intervient de la même manière. « C’était mon père… C’est mon mari… C’est mon épouse… C’est mon enfant… » La violence incompréhensible, disproportionnée, subite, provoque le même état chez sa victime. Elle est sidérée. Elle devient mutique. Elle n’ose ni parler ni agir. Et ces impossibilités vont laisser place au stress, et au traumatisme.
Anne-Laure Buffet